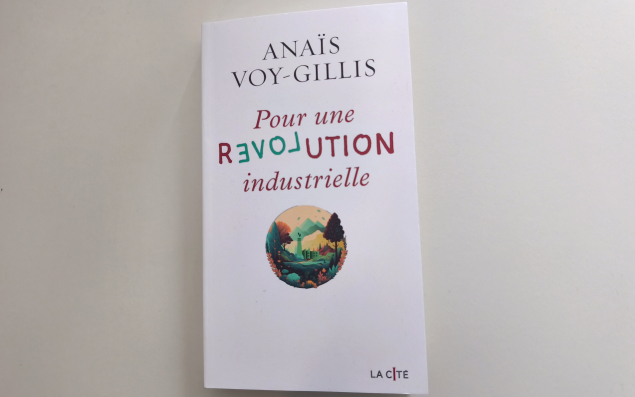Vous êtes aujourd’hui directrice de la stratégie et de la RSE du groupe lyonnais Humens (400 salariés), un acteur de la chimie minérale de spécialités. En quoi votre poste dans l’industrie façonne votre regard de chercheuse ?
Ça change beaucoup de choses, parce que l’industrie n’est pas un concept : c’est une réalité de contraintes, de choix, d’investissements, de compromis. Humens produit notamment du carbonate et du bicarbonate : c’est de la chimie, donc c’est aussi un sujet de décarbonation, de ressources, d’acceptabilité, de chaîne de valeur. Quand on est dans une industrie émettrice, on ne peut pas se payer le luxe d’un discours incantatoire. On se confronte aux coûts, au temps long, aux partenaires, aux arbitrages. Et ça nourrit aussi mon travail de géographe : l’industrie, ce sont des territoires, des emplois, des compétences, et des effets d’entraînement.
Depuis 2020, on n’a jamais autant parlé de réindustrialisation. Pourtant, vous dites que le mot fait consensus… mais pas la démarche. Pourquoi ?
Parce que "réindustrialiser" est devenu un mot-valise. On l’utilise comme un slogan, sans toujours expliciter : réindustrialiser pour quoi faire, et au service de quel projet de société ? On peut empiler des plans, parler de souveraineté, de relocalisation, de compétitivité… Mais derrière, il faut trancher : quelle industrie veut-on encourager, laquelle veut-on limiter, quels produits sont compatibles avec nos objectifs climatiques, notre modèle social, nos ressources ? Tant qu’on évite ces questions, on reste au bord du sujet.
Et en Vendée, dans le cadre de l’événement "Ici Industrie", parler de réindustrialisation peut paraître presque… décalé.
Oui, parce que ce territoire fait figure d’exception. Quand une partie de la France se rêvait "post-industrielle", ici, l’industrie a continué à exister, à investir, à recruter, à transmettre. Il y a un contraste très fort : la Vendée n’a pas renoncé à l’industrie, y compris quand le reste du pays tournait le dos aux usines et aux métiers. Et ce contraste, il est précieux, parce qu’il montre qu’aucune trajectoire n’est immuable : on peut résister, on peut rebondir, on peut créer de la valeur ici.
Justement, vous insistez sur la dynamique d’emplois : depuis 1975, la Vendée a continué à créer des emplois industriels, là où la France en détruisait massivement. Comment vous l’expliquez ?
Il y a plusieurs facteurs. D’abord, l’ancrage : des entreprises attachées à leur territoire, une culture de l’industrie vécue comme une fierté, pas comme un résidu du passé. Ensuite, la diversification : les territoires trop dépendants d’un seul secteur - on pense à l’automobile dans l’Est et le Nord — encaissent les chocs de plein fouet. La Vendée a davantage amorti les crises parce qu’elle n’était pas mono-activité et a su maintenir une dynamique de diversification.
"L’actionnariat familial de nombreuses entreprises vendéennes nourrit aussi cette vision de la coopération et du temps long"
Et il y a un facteur décisif : la coopération. Sur certains territoires, la désindustrialisation a aussi été une affaire de déliaison : donneurs d’ordres, sous-traitance, financement, décisions… se sont progressivement détachés du local. Ici, on voit plus souvent une logique d’écosystème et d’interdépendance. L’actionnariat familial de nombreuses entreprises vendéennes nourrit aussi cette vision de la coopération et du temps long.
Vous dites même que ce "secret" vendéen est mal reproduit ailleurs : la capacité à coopérer. Qu’entendez-vous par là ?
Coopérer, ce n’est pas être "gentil", c’est être stratégique. C’est accepter le temps long, partager de l’information, se coordonner sur des compétences, sur des projets, sur l’export, parfois sur l’innovation. Beaucoup de territoires voudraient les bénéfices de l’industrie sans l’effort collectif : or l’industrie, ça marche en chaîne. Si la chaîne se fragilise, tout se fragilise. Et quand on coopère, on ancre. Une entreprise qui achète local, qui travaille avec une chaîne de valeur de proximité, qui comprend son rôle dans le territoire, est plus robuste qu’un site "hors-sol" qui n’a rien accroché au local : ni décisions, ni achats, ni partenaires.
Vous faites une distinction intéressante : vous parlez moins de "réindustrialisation" que de "renaissance industrielle". Pourquoi ce choix de mots ?
Parce que "réindustrialiser" déclenche souvent deux réactions : soit "c’est impossible", soit "on ne va pas refaire comme avant". Et effectivement, on ne fera pas comme avant : automatisation, numérique, IA, gains de productivité… Les sites ne ressembleront pas aux années 1970.
En revanche, "renaissance" dit autre chose : maintenir et moderniser l’existant, relocaliser là où c’est stratégique, et localiser de nouvelles activités. Mais à une condition : ne pas sacrifier le tissu industriel déjà là. Si on ferme des usines à tour de bras et qu’on inaugure uniquement des gigafactories, on se raconte une histoire qui ne tient pas.
Vous mettez aussi en garde contre une illusion : croire que les start-up industrielles suffiront…
Je ne suis pas anti-start-up. Je dis simplement : industrialiser est un métier. Et parfois, on veut "scaler" trop vite, sans étapes, sans culture industrielle, sans adossement au tissu existant. On a vu des exemples en Europe où l’industrialisation est beaucoup plus difficile que le pitch. La bonne question, c’est : comment on embarque les industriels déjà présents ? Ils ont les savoir-faire, les ateliers, la capacité à monter en cadence, à sécuriser la qualité. Si la politique publique mise tout sur le "nouveau" sans faire le lien avec l’existant, on perd de la valeur. Une start-up comme Ynsect (qui a inauguré une usine de 45 000 m² dans la Somme pour produire des protéines d’insectes et qui a été placée en liquidation judiciaire fin 2025, NDLR) selon moi, a voulu grandir trop vite.
Vous décrivez un contexte géopolitique très instable : États-Unis, Chine, Ukraine… En quoi cela change-t-il la donne pour l’industrie européenne ?
Ça change tout, parce que la mondialisation "heureuse" est derrière nous. Nous dépendons de chaînes de valeur fragiles : on l’a vu avec les semi-conducteurs, avec les médicaments pendant la crise Covid, et on le verrait à nouveau, brutalement, avec un choc majeur en Asie. Par ailleurs, la demande européenne est atone, les industriels perdent des parts de marché, et la concurrence extra-européenne - notamment chinoise — est extrêmement agressive, en partie parce que la Chine est en surcapacité et cherche à écouler vers l’Europe ce qu’elle ne peut plus écouler aux États-Unis ou sur son propre marché intérieur. Dans ce contexte, l’industrie n’est pas un sujet nostalgique : c’est un sujet de résilience, donc de liberté.
Sur l’Europe, votre diagnostic est sans détour : elle ne se donne pas les moyens de rivaliser avec les États-Unis ou la Chine.
L’Europe empile des stratégies nationales, mais elle a du mal à faire politique commune. Vingt-sept pays, ce sont vingt-sept intérêts industriels. On pourrait imaginer un levier puissant : la commande publique européenne, un "Buy European Act", des critères carbone clairs… Mais ça patine, et quand on met en place un mécanisme, on le rend souvent si complexe qu’il ne protège pas vraiment le producteur européen. Or, face à des puissances qui planifient, qui standardisent, qui sécurisent leurs matières premières et leurs routes logistiques, et qui ont un immense marché intérieur, l’Europe doit accélérer.
"Tout le monde juge la réindustrialisation indispensable, mais personne n’assume le coût et les choix associés"
Vous revenez souvent sur un point très concret : qui paie la réindustrialisation ?
C’est le nœud. Les industriels ne veulent pas payer seuls, parce qu’ils doivent rester compétitifs. Les consommateurs refusent, au nom du pouvoir d’achat. L’État rechigne, parce qu’il est endetté. Résultat : tout le monde juge la réindustrialisation indispensable, mais personne n’assume le coût et les choix associés. Pourtant, si on veut décarboner, innover, moderniser, il faut des financements de temps long, des partenaires qui acceptent le risque industriel. La décarbonation d’un site peut représenter des millions d’euros d’investissement. Ce n’est pas anodin. Accepter un coût légèrement plus élevé pour des produits fabriqués en France ne contribue-t-il pas aussi à soutenir l’emploi, les compétences et l’activité économique nationale, et donc à réduire indirectement certaines dépenses publiques liées au chômage ?
Cette question du temps long vous ramène à la transmission. En Vendée, c’est un sujet majeur. Quels risques voyez-vous ?
Le risque, c’est une rupture de culture et de gouvernance. La transmission familiale se passe parfois très bien, parfois non. Quand la famille sort du capital, qui reprend ? Les managers ? Les salariés ? Souvent, il faut des montages financiers lourds. On ouvre alors à des fonds, et ce n’est pas "mal" en soi, mais ça change le rapport au temps : horizon de sortie du capital à 5-7 ans, exigences de rentabilité, arbitrages contre des projets à retour sur investissement sur 10 ans. Et l’autre risque, c’est la vente à des capitaux étrangers, faute d’acteurs nationaux capables de se mobiliser.
Autre sujet que vous avez mis sur la table : l’export. Vous sentez un déficit de "chasse en meute" en France.
Aujourd’hui, 10 % du PIB français correspond à l’activité manufacturière. C’est 15 % en Italie et 17 % en Allemagne. Autre constat, ils exportent plus que nous. Une première raison ? L’Allemagne et l’Italie ont une culture plus collective sur l’export : on avance ensemble, on raconte une histoire commune, on attaque des marchés en équipe. En France, on peut parfois manquer de solidarité sectorielle, alors que la concurrence mondiale est féroce.
Et il y a un autre sujet : la modernisation. Les entreprises allemandes ou italiennes ont souvent une obsession de la montée en gamme, de l’investissement productif, de la technologie de pointe. En France, ce n’est pas homogène : certaines sont très en pointe, d’autres ont moins "faim", pour le dire simplement. Par ailleurs, dans un monde où des acteurs sont prêts à casser les prix pour prendre des parts de marché, à noyer la concurrence avant d’augmenter ses prix une fois seul sur le marché, cette attitude peut coûter très cher.
Vous insistez sur l’environnement, mais en élargissant au-delà du CO₂ : eau, biodiversité, ressources. Pourquoi est-ce central pour l’industrie ?
Parce que l’industrie dépend du vivant et des ressources : eau, matières, énergie, conditions climatiques. On parle beaucoup de carbone, mais le cycle de l’eau va devenir un sujet industriel majeur : trop d’eau, pas assez d’eau, températures, rejets, process… Et même nos choix énergétiques - nucléaire, électrification - ont des dépendances physiques. La transition, ce n’est pas seulement une contrainte : c’est aussi un sujet de coûts futurs, de risques, de continuité d’activité. Consommer moins de ressources, c’est aussi gagner en résilience. Alors la réindustrialisation, oui, pour quel projet de société ? Une société sans limites de consommation ou une société économe en ressources, qui encourage le réemploi, la seconde main ?
Vous comparez la Chine et l’Italie, avec deux modèles très différents. Qu’est-ce que ces comparaisons nous disent pour un territoire comme la Vendée ?
La Chine montre ce que peut produire la planification sur vingt ans : filières, financement, normes, matières premières, routes logistiques… L’Italie, elle, montre la force des districts industriels : des clusters, une coopération territoriale, une maîtrise de la valeur. Pour la Vendée, je vois un point commun avec l’Italie : cette capacité à fonctionner en écosystème, à coopérer, à construire une identité industrielle partagée. C’est un atout considérable dans un monde instable.
Si vous deviez adresser trois messages aux Vendéens, quels seraient-ils ?
Le premier ? Vous avez déjà prouvé votre résilience : continuer à créer des emplois industriels depuis 1975, ce n’est pas anecdotique au moment où ailleurs en France l’emploi industriel s’effondrait. Mais le défi n’est plus de "reconstruire" : c’est de vous projeter en 2040-2050. Le second ? La transmission est votre sujet stratégique : entreprises, savoir-faire, culture industrielle. Si vous perdez ça, vous perdez votre différenciation. Le troisième ? Dans un monde instable, les territoires qui traversent les crises sont ceux qui n’attendent pas tout de l’État : ils s’organisent, coopèrent, clarifient une feuille de route, anticipent les chocs. L’industrie, c’est du temps long et le temps long se prépare.
Vous avez commencé à travailler sur l’industrie en 2014 : à l’époque, ce n’était pas "tendance". Aujourd’hui, vous sentez un basculement ?
Oui. Malgré les normes, la fiscalité, les difficultés, je n’ai jamais vu autant de personnes qui veulent se battre pour faire en France. Et je crois que ça dépasse l’industrie : c’est la question de l’avenir qu’on laisse, de la liberté qu’on conserve, des valeurs qu’on défend, et de ce qu’on choisit de produire. L’enjeu est collectif : industriels, État, territoires, citoyens. Sans imaginaire industriel mobilisateur, on n’embarque pas la société. Mais l’envie, dans notre pays, elle existe.