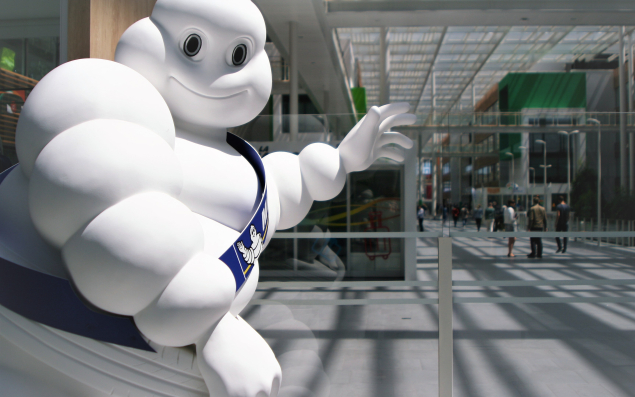Rendre leur liberté et leur autonomie aux salariés. Le concept semble presque à la mode. Parfois, on parle d’entreprise libérée. D’autres fois, d’entreprise responsabilisante, autonomisante, néo-participative ou encore post-bureaucratique. “Ces termes sonnent un peu comme une marque employeur, un label marketing. Ils ont parfois été instrumentalisés, notamment pour redorer le blason du management, concède Hélène Picard, chercheure à Grenoble École de Management. Mais ils rassemblent des entreprises qui partagent des traits communs, des dirigeants qui ont une même philosophie, une même aspiration.
Et à écouter ceux qui ont choisi de “libérer” leur entreprise en lister les avantages, on comprend l’onirisme du concept : plus d’engagement de la part des salariés, de meilleures performances, moins d’absentéisme, plus de bien-être au travail, moins de turn-over, une meilleure capacité à répondre aux besoins des clients… La “clé” : créer les conditions pour que les salariés puissent choisir, en concertation avec leurs collègues, leurs horaires de travail, leurs dates de congés, leur hausse de salaire, mais également les consulter et les intégrer dans les prises de décisions, stratégiques ou de gestion courante, de l’entreprise.
Bien souvent, c’est d’eux, les chefs d’entreprise, qu’émane cette volonté de transition. “Ces dirigeants ne sont plus seulement animés par l’idée de faire du profit”, explique Olivier Frérot, polytechnicien, ancien directeur de l’agence d’urbanisme de Lyon, désormais spécialiste des nouvelles formes d’organisation. “Pour eux, l’argent devient un moyen et non une fin. Se pose alors la question de ce qui motive les humains, ce qui donne un sens au travail, si ce n’est plus l’argent.”
Convaincre les salariés
“Il s’agit avant tout d’une vraie volonté philosophique du chef d’entreprise. Si on n’est pas prêt à avoir confiance, cela ne peut pas fonctionner”, rappelle Julien Russier, dirigeant de la PME Edrastop Composite (CA : 1,5 M€ / 15 salariés), entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux composites et lubrifiants pour des applications industrielles au Chambon-Feugerolles (Loire), qui, il y a un an et demi, n’a plus eu envie d’avoir sa casquette de “père" dans son entreprise – il a déjà cinq enfants. “Le plus important pour que ça fonctionne, c’est que le dirigeant porte la démarche. Sinon, c’est mort, abonde Laurent de la Clergerie, dirigeant de l’entreprise lyonnaise cotée LDLC (CA 2020 : 635 M€ / 1 000 salariés), qui s’est fixée comme objectif, à terme, de supprimer les postes de managers, pour les remplacer par des leaders, désignés par leurs pairs.
“Il faut donner confiance à ses salariés, les convaincre de vous suivre dans cette démarche”, explique-t-il. Un changement qui peut parfois faire peur. “Lorsqu’on s’est lancé dans cette démarche plus participative, il y a cinq ans, nos salariés ont cru à une logique d’échec. Pour eux, c’étaient les entreprises en difficulté qui adoptaient ce type de modèle”, se souvient Pierre-Yves Antras, directeur général de l’office public de l’habitat (OPH) Haute-Savoie Habitat, premier bailleur social du département (300 salariés /19 736 logements) qui s’est donné pour mission de chasser la souffrance au travail." Tout va bien ? Qu’est-ce que vous nous cachez ?" nous a-t-on demandé. Il a fallu expliquer, rassurer, donner envie de participer.”
Un travail d'abord sur soi
Le plus souvent, cette transition demande au dirigeant de s’impliquer personnellement, de se remettre en question. “L’objectif est d’être dans l’accompagnement, de ne plus se rapporter au triptyque commandement/exécution/reporting. Cela implique de faire appel à ses émotions plus qu’à sa raison, pour être à l’écoute des autres”, raconte Jérémie Bataille, fondateur et dirigeant de la start-up lyonnaise Flexjob, qui accompagne les entreprises vers de nouvelles façons de travailler et s’est elle-même construite, il y a cinq ans, sur le modèle de l’entreprise libérée. “Mais nous n’avons pas été formés, ni même éduqués en ce sens. C’est d’abord un travail sur soi qu’il faut mener.”
Le constat a été similaire chez le géant du pneu Michelin (CA 2019 : 24 milliards / 127 000 salariés). Au milieu des années 2010, le groupe de Clermont-Ferrand avant initié une expérimentation de “responsabilisation” durant deux ans, au sein de huit usines pilotes, qu’il a ensuite souhaité étendre à ses 80 usines. “Mais la transition restait cantonnée à quelques îlots, raconte Pierre-Alexandre Anstett, directeur de l’innovation sociale et ancien directeur de l’usine Michelin de Cholet (Maine-et-Loire). Nous avons compris que la base du changement était les managers. On leur demandait de ne plus être omnipotents. Ce faisant, on les dépossédait de ce qui les valorisait jusqu’alors.” Il y a deux ans, Michelin a lancé un nouveau modèle de leadership, baptisé Icare. Un modèle présenté au top 1 000 managers par le nouveau président, Florent Menegaux, au moment de sa prise de fonction au printemps 2019. “Il a expliqué comment lui-même s’était engagé dans une remise en question de ses pratiques avec l’aide d’un coach, et a invité les managers à faire de même. L’accueil a été enthousiaste, car la démarche de Florent Menegaux était aspirationnelle. ”
Prendre le temps
“Tous ne se sont cependant pas ralliés à la démarche. Certains cadres nous ont dit qu’ils ne s’en sentaient pas capables, précise Pierre-Alexandre Anstett, et ont préféré être placés dans des fonctions qui les exposaient moins à cette transition.” “Tout le monde ne peut pas adhérer du jour au lendemain. Il faut apprendre à prendre en compte cette diversité et donner le temps”, acquiesce Jérôme Bataille de Flexjob.
Donner le temps et le prendre. “La vie de manager change. En fait, on manage moins. On coache, on accompagne, explique Laurent Mangue, cofondateur de Sogilis (CA 2019 : 3,3 M€ / 50 salariés), éditeur de logiciels sur-mesure à Grenoble. Je passe plus de temps à manager 50 personnes que je n’en passais à en manager 500 dans mon ancien groupe.” Tous les ans, le PDG de LDLC Laurent de la Clergerie prend quant à lui le temps de rencontrer chacun de ses 800 salariés du siège pendant une heure, par petits groupes. “Cela me prend plus d’une semaine mais, à travers les questions qu’ils me posent, je vois apparaître tous les problèmes, tous les points sur lesquels il faut les accompagner.”
Donner les moyens et faire confiance
Haute-Savoie Habitat a aussi décidé de mettre les moyens. “Pour inciter les salariés à participer à la vie de l’entreprise, nous avons lancé un appel à projets au début du processus”, rapporte Vola Potinet, la coach interne à l’OPH. Les équipes ont également été formées à la gestion de projet en partenariat avec la CCI. “Le fait d’écouter et de mettre les moyens pour des réalisations concrètes a provoqué un effet papillon".
“En termes de budget, cette démarche n’est pas neutre”, prévient tout de même Pierre-Alexandre Anstett. Et pour cause ! Michelin assure avoir investi plusieurs millions d’euros pour offrir un accompagnement avec un coach extérieur certifié à ces top managers. “On n’est pas dans l’incantation”, tient à souligner le spécialiste de l’innovation sociale.
Parmi les huit usines pilotes qui avaient mené une phase d’expérimentation, l’une a souhaité s’emparer de la question de la rémunération, se souvient Pierre-Alexandre Anstett. “Comme on leur avait demandé ce qu’ils pensaient pouvoir faire mieux, voire mieux que leur manager, si on leur en donnait les moyens, ils ont estimé être les plus à même de connaître les contributions de chacun au sein de l’équipe et décider des augmentations”, rapporte le directeur. Les dirigeants craignaient que les collaborateurs choisissent une répartition égalitaire, évacuant simplement le problème de la hausse de salaire. Paradoxalement, au final, les écarts entre les augmentations de chacun étaient encore plus importants que d’habitude et personne ne s’en est plaint.
Droit à l’erreur
“Il est impératif de mettre en place un système où on a le droit de se tromper, souligne Laurent Mangue, de Sogilis. Parfois, nous sommes allés là où nous ne voulions pas aller. Cela n’a été reproché à personne. Il faut pouvoir essayer. ” Mais “il faut comprendre que ce sont des vraies décisions qui nous échappent, renchérit Julien Russier, PDG d’Edrastop Composite. Récemment, nous avons contracté un prêt garanti par l’État. Or ce n’est pas forcément la décision que j’aurais prise si j’avais été seul !”, consent-il.
Reste que, sans ce lâcher-prise, le modèle peut ne pas être pérenne. Car tout l’enjeu est là pour le dirigeant : avoir la force d’inspirer ses salariés, de les accompagner vers l’autonomie, puis de se mettre en retrait et finalement de laisser sa place dans une organisation rodée. Chez Michelin, Florent Menegaux a pris la suite de Jean-Dominique Senard et poursuit la démarche lancée. Sogilis essaime en créant des filiales. Avant de passer à l’entreprise libérée, LDLC met en place, au 1er janvier, la semaine de 4 jours payée 5. C’est le pari de « l’intelligence collective », indique Laurent de la Clergerie. Et si, à la lueur de la crise sanitaire et économique qui traverse l’Hexagone, ces entreprises faisaient leur « preuve de concept » ?